Vendredi 17 octobre à 20h30 au foyer de Juzet de Luchon : PORTRAITS D’ALAIN CAVALIER
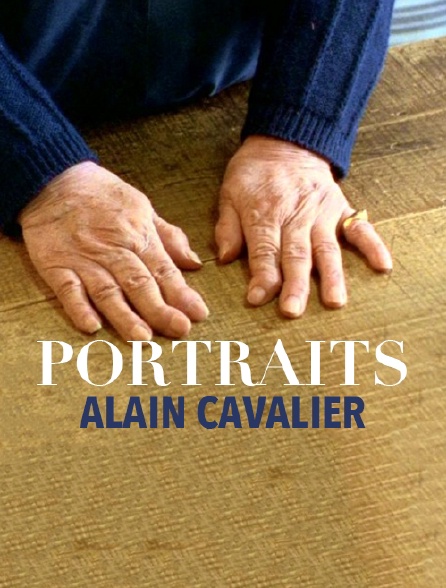
Dès ses débuts, le cinéma se développe dans deux directions différentes, en utilisant les mêmes caméras et les mêmes salles de projection. D’un côté, avec les frères Lumière, les films documentaires (L’arrivée du train en gare de La Ciotat) ; d’un autre côté, avec Méliès par exemple, la fiction (Le voyage dans la Lune). Ensuite, des cinéastes comme Alain Cavalier passeront volontairement de l’un à l’autre, et souvent, même, en mêlant les deux. Son parcours dans l’univers de la création cinématographique le montre clairement.
Après des études d’Histoire, et le passage par l’IDHEC, Alain Cavalier devient l’assistant de Louis Malle, notamment pour Ascenseur pour l’échafaud. Il se fait connaître au début des années 60 par deux films autour de la guerre d’Algérie : Le Combat dans l’île (1961) et L’Insoumis (1964). On y retrouve de jeunes débutants : Alain Delon ou Romy Schneider… Puis il commence à être vraiment connu avec des films comme Mise à sac (1967) et La Chamade, tiré du roman de Françoise Sagan.
Il se dirige ensuite progressivement vers un cinéma plus expérimental, entre le documentaire et la fiction : Un étrange voyage vient récompenser en 1980 l’audace de son metteur en scène par le prix Louis Delluc. Il obtient enfin en 1986 un grand succès avec un film de fiction, Thérèse : simple et radical, le film questionne la sainteté au travers de la vie de la jeune carmélite Thérèse de Lisieux. Il est ovationné au festival de Cannes 1986 où il reçoit le prix du jury, puis est plébiscité aux Césars l’année suivante, avec six récompenses obtenues dont celles du meilleur film, du meilleur réalisateur et du meilleur scénario.
Ensuite, tout au long des années 90 et 2000, Alain Cavalier affine progressivement une nouvelle manière de faire des films. Réduisant ses équipes techniques, renonçant peu à peu à toute action dramatique traditionnelle, il aspire de plus en plus à filmer au plus près des êtres, ce qui va l’amener inévitablement vers le documentaire. Il va épurer son oeuvre pour se définir lui-même comme « filmeur », ne travaillant plus qu’en DV pour être au plus près de son sujet. En témoigne Le filmeur (2004) qui se présente comme un journal intime filmé de 10 ans de vie.
C’est dans tout ce contexte très personnel que se situent les 24 portraits réalisés entre 1987 et 1991, dont il dit lui-même :
« Ces portraits sont des rencontres que je voudrais garder de l’oubli, ne serait-ce que pendant les quelques minutes où elles sont devant vous. Ce sont des femmes qui travaillent, qui font des enfants et qui, en même temps, gardent un esprit d’indépendance. J’ai tourné vingt-quatre portraits de treize minutes. J’ai choisi cette courte durée pour plusieurs raisons : ne pas ennuyer, échapper à toute coupure publicitaire, réaliser le film vite, dans un élan et sans trop de ratures. Je suis un amateur de visages, de mains et d’objets. Rendre compte de la réalité ne m’attire pas. La réalité n’est qu’un mot, comme sa sœur jumelle, la fiction, que je pratique par ailleurs, avec un plaisir différent. »
Bien sûr, parmi tous ces portraits, c’est seulement une sélection de quelques-uns des meilleurs qui sera présentée.
Pour aller plus loin
> Une belle présentation de l’ensemble des 24 portraits :
> L’interview en vidéo d’« Alain Cavalier, portraitiste » sur France Culture en 2018 ( 23minutes ) :
